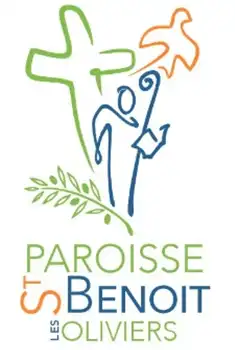L'onction des malades
Sacrement de la tendresse de Dieu

Le sacrement de l’onction des malades
Le Sacrement des Malades est le Sacrement pour le temps de la Maladie…
Recevoir le Sacrement des Malades est un geste de foi et d’espérance. C’est demander à Dieu la force dans l’épreuve et le soutien dont on a besoin…
Après une lecture de la Parole de Dieu, le prêtre impose les Mains… C’est le geste de Jésus sur les malades pour les confier à la protection de Dieu et appeler sur eux la Paix, la Joie, la Vie…
Suit l’onction d’Huile sur le front et dans la paume des mains. Jésus, nous dit St Marc, envoyait ses apôtres imposer les mains aux malades et faire sur eux une onction d’huile, en signe de remède, de réconfort et d’apaisement…
On termine par le Notre Père et une prière à Notre Dame…
Dès les origines : une onction pour les malades
Un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, banda ses plaies, y versant de l’huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l’hôtellerie et prit soin de lui (Lc 10,33-34). Les Pères de l’Église ont mis en lumière l’identité du Bon Samaritain qui s’approche de cet homme blessé mortellement. Il s’agit du Verbe de Dieu qui, dans le mystère de son incarnation, a pris sur lui notre nature humaine. Tout au long de l’Évangile, Jésus se révèle le Sauveur en allant à la rencontre de la souffrance physique et morale. « Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques ; il chassa les esprits d’un mot et il guérit tous les malades afin que s’accomplît l’oracle d’Isaïe le prophète : ‘Il a pris nos infirmités et s’est chargé de nos maladies’ » (Mt 8,16-17 ; cf. Is 53,4). Citant le poème du Serviteur souffrant d’Isaïe, l’évangéliste Matthieu suggère le transfert de nos maux physiques, et plus encore spirituels, sur la personne de Jésus. Celui-ci n’a pas seulement triomphé de la maladie par ses interventions miraculeuses, mais aussi et surtout dans son mystère pascal. À Gethsémani, il a porté toute la faiblesse humaine et en a éprouvé de la tristesse : « mon âme est triste à en mourir » (Mt 26,38). La Passion et la Résurrection exaltent la victoire du Christ sur la souffrance et la mort en ouvrant aux hommes l’accès au salut total : dans la communion avec Dieu.
Le Christ Bon Samaritain ne peut demeurer avec l’homme blessé qu’il est venu secourir. C’est pourquoi il donne deux deniers à l’hôtelier pour qu’il prenne soin de lui. Ainsi confie-t-il les sacrements, le pain, le vin et l’huile qui prolongent ses propres gestes de salut en attendant qu’il revienne. Le ministère de guérison fait partie de l’envoi en mission des disciples : « ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris » (Mc 16,18).
Une « extrême » onction ?
Depuis le concile Vatican II, l’Église a souhaité retrouver une application plus large de ce sacrement :
« “L’extrême-onction”, qu’on peut appeler aussi et mieux l’Onction des malades n’est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à la dernière extrémité. Aussi, le temps opportun pour le recevoir est déjà certainement arrivé lorsque le fidèle commence à être en danger de mort par suite d’affaiblissement physique ou de vieillesse. » (Sacrosanctum concilium, 73)
Il convient de bien comprendre ce passage, qui invite à considérer le « danger de mort » d’une manière assez large. Le Code de droit canon (can. 1004) précise que l’Onction concerne « tout fidèle qui […] commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse », ce qui exclut de la réserver à des agonisants. Elle peut ainsi être reçue par des personnes âgées, même en bonne santé, car pour elles la perspective de la mort se rapproche selon toute probabilité. En revanche, elle ne s’applique pas à des maladies bénignes : elle n’aurait pas de sens pour une jambe cassée.
L’Onction des malades peut être également reçue au seuil d’une opération importante.
En cas d’aggravation de la maladie, elle peut être réitérée.
La célébration de l’Onction des malades
Seuls les prêtres sont les ministres de ce sacrement, selon ce qui est indiqué par saint Jacques.
L’Onction se fait avec l’huile consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale : « le curé demandera les huiles à son Évêque propre. » (CIC, can. 847)
Elle est généralement précédée du sacrement du Pardon et suivie de l’Eucharistie, qu’elle soit intégrée dans une messe ou que le malade communie seulement, comme c’est le cas pour le viatique.
La cérémonie commence l’imposition des mains et une prière sur les malades. Le geste de l’imposition des mains renvoie peut-être à la prescription de Jésus à ses disciples avant son Ascension :
« Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : […] ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront écrits. » (Mc, XVI, 17 et 18).
Puis le prêtre fait les onctions sur le front et les mains en disant :
« N…, par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’Il vous sauve et vous relève. »
Les effets de l’Onction des malades
Le premier effet du sacrement est l’augmentation de la grâce sanctifiante : comme tout sacrement des vivants, il produit dans l’âme une augmentation de la grâce. C’est une « grâce de réconfort, de paix et de courage pour vaincre les difficultés propres à l’état de maladie grave ou à la fragilité de la vieillesse. Cette grâce est un don du Saint-Esprit qui renouvelle la confiance et la foi en Dieu et fortifie contre les tentations du malin, tentation de découragement et d’angoisse de la mort (cf. Hébreux 2, 15). Cette assistance du Seigneur par la force de son Esprit veut conduire le malade à la guérison de l’âme, mais aussi à celle du corps, si telle est la volonté de Dieu » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1520). Les chrétiens des premiers siècles accordaient un rôle important à cette guérison corporelle que le sacrement peut produire.
L’onction des malades produit aussi l’union du malade à la Passion du Christ : « Par la grâce de ce sacrement, le malade reçoit la force et le don de s’unir plus intimement à la Passion du Christ : il est d’une certaine façon consacré pour porter du fruit par la configuration à la Passion rédemptrice du Sauveur. La souffrance, séquelle du péché originel, reçoit un sens nouveau : elle devient participation à l’œuvre salvifique de Jésus » (Ibid., n° 1521).
« En outre, « s’il a commis des péchés, ils lui seront remis » (Jacques 5, 15). Ce sacrement efface donc les péchés, car Dieu pardonne non seulement les péchés véniels, mais aussi les péchés mortels au cas où le malade serait repenti mais n’aurait pas pu recevoir le sacrement de la pénitence.
Souffrir et mourir avec le Christ par Son Eglise
La souffrance du malade n’est pas un isolement tragique pour le chrétien car Dieu dans son amour pour nous est proche des souffrants par sa Passion dont ce sacrement est un signe. L’Église « exhorte les malades à s’unir spontanément à la passion et à la mort du Christ pour contribuer ainsi au bien du Peuple de Dieu. » (Lumen gentium, 11)
L’Onction des malades, même si elle n’est plus seulement « extrême-onction », ne demeure pas moins la préparation naturelle du chrétien à la rencontre en face-à-face avec Dieu :
Le malade reçoit une grâce ecclésiale. En effet, « en s’associant librement à la Passion et à la mort du Christ », il apporte « sa part pour le bien du Peuple de Dieu » (concile Vatican II, constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n° 11). En célébrant ce sacrement, l’Église, dans la communion des saints, intercède pour le bien du malade. Et le malade, à son tour, par la grâce de ce sacrement, contribue à la sanctification de l’Église et au bien de tous les hommes pour lesquels l’Église souffre et s’offre, par le Christ, à Dieu le Père » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1522).
Enfin le sacrement aide à s’abandonner avec confiance entre les bras miséricordieux de Dieu son Père. Il est donc une préparation au dernier passage. S’il est administré à ceux qui souffrent de maladies ou d’infirmités graves, « il l’est à plus forte raison à ceux qui sont sur le point de sortir de cette vie, de sorte qu’on l’a aussi appelé sacramentum exeuntium », « sacrements de ceux qui quittent ce monde ». L’onction des malades « achève de nous conformer à la mort et à la Résurrection du Christ, comme le baptême avait fait commencé de le faire. Elle parachève les onctions saintes qui jalonnent toute la vie chrétienne ; celle du baptême avait scellé en nous la vie nouvelle ; celle de la confirmation nous avait fortifiés pour le combat de cette vie. Cette dernière onction munit la fin de notre vie terrestre comme d’un solide rempart en vue des dernières luttes avant l’entrée dans la Maison du Père » (Ibid., n° 1523).
Onction des malades et viatique
La tradition de l’Eglise rapproche l’onction des malades à la communion au Corps du Christ : « À ceux qui vont quitter cette vie, l’Église offre, en plus de l’Onction des malades, l’Eucharistie comme viatique » (CEC, 1524)
Cette pratique a pour but de faire rentrer pleinement le chrétien dans l’amour de Dieu et elle tire sa force de la promesse du Christ :
« Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » (Jn, VI, 54)